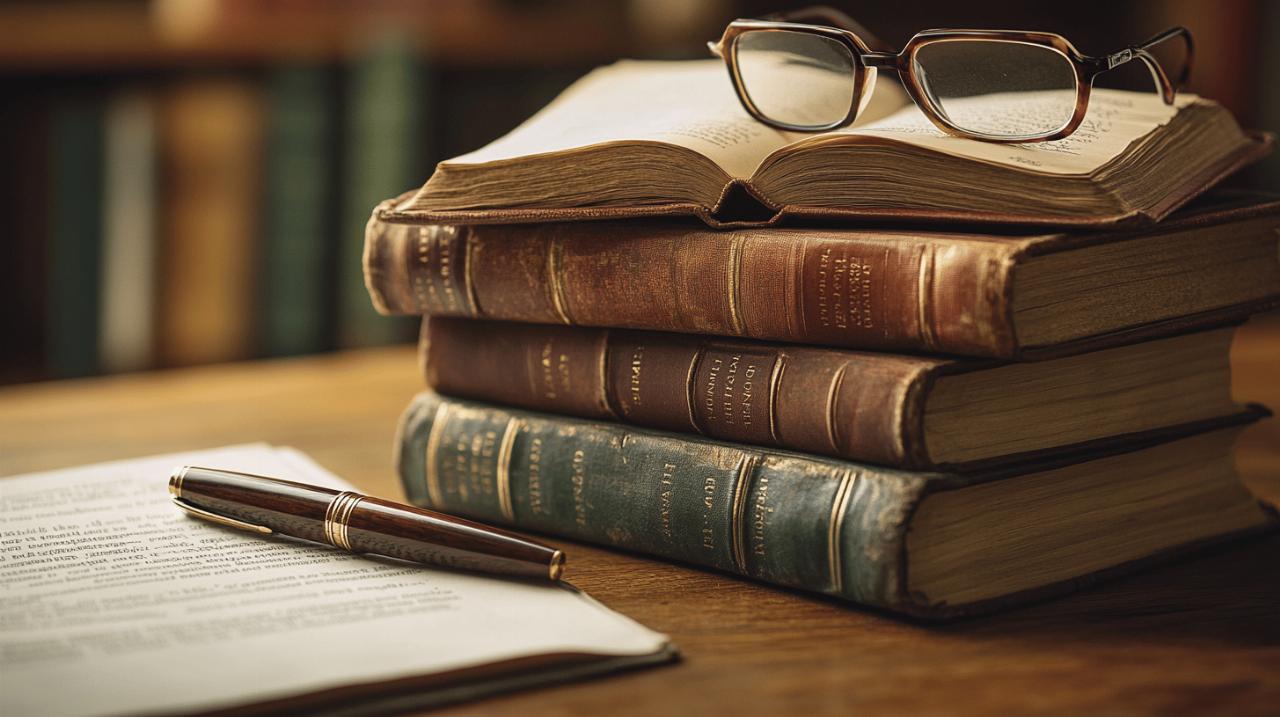Au XVIIe siècle, dans un monde régi par des codes moraux rigides, émerge une figure théâtrale audacieuse et provocante : le Don Juan de Molière. Cette œuvre majeure présente un protagoniste qui incarne le libertinage sous ses aspects les plus frappants, bouleversant les normes sociales et religieuses de l'époque. À travers ce personnage subversif, Molière signe une pièce qui transcende la simple comédie pour devenir un miroir tendu à la société du Grand Siècle.
Le personnage de Don Juan et sa place dans l'œuvre de Molière
Don Juan représente un tournant dans la carrière de Molière. Cette pièce, moins légère que d'autres comédies de l'auteur, aborde des questions profondes sur la foi, les apparences sociales et l'hypocrisie des mœurs. Le dramaturge y déploie toute sa maîtrise pour créer un protagoniste ambigu qui fascine autant qu'il repousse.
La construction d'un archétype du séducteur sans scrupules
Molière façonne son Don Juan selon les traits que les apologistes du XVIIe siècle attribuaient aux libertins. Loin d'être un véritable philosophe, son personnage utilise le libertinage comme un masque commode pour justifier ses passions. Paré d'une perruque blonde, de plumes et d'habits dorés selon la mode de la Cour, Don Juan se sert principalement de promesses de mariage pour séduire – une forme de sacrilège dans cette société profondément religieuse. Un décalage existe entre son discours grandiose sur la séduction et sa pratique réelle, où il se montre parfois maladroit et embarrassé. Il n'incarne pas un véritable penseur mais plutôt ce que Garasse aurait appelé un « yvrognet » – un homme qui reconnaît Dieu mais vit comme s'il n'existait pas, comptant sur un repentir tardif.
Don Juan comme outil de critique sociale
À travers ce personnage, Molière dresse une critique des apparences et de l'hypocrisie sociale. Don Juan n'est pas un révolutionnaire : il exploite les conventions quand elles servent ses intérêts. Ses discours philosophiques, prononcés devant des interlocuteurs incapables de les comprendre comme Sganarelle, révèlent moins une posture intellectuelle solide qu'une stratégie pour dominer autrui. Pascal aurait reconnu dans ce libertinage l'indifférence qu'il qualifiait de « paradoxemonstrueux ». Molière utilise ce protagoniste pour mettre en lumière les contradictions d'une société où le paraître prime sur l'être. Don Juan attend la mort de son père pour jouir de sa fortune et de son rang social – sa philosophie n'est qu'un vernis masquant ses motivations égoïstes. Il incarne ainsi le portrait du « fauxlibertin » que dressaient les défenseurs de la foi, un homme dont l'attitude impie relève davantage de la mode que d'une véritable conviction.
La relation complexe entre Don Juan et Sganarelle
La pièce de Molière « DomJuan » met en scène un duo de personnages dont la dynamique relationnelle fascine autant qu'elle interroge. D'un côté, le séducteur aristocrate Dom Juan, représentant du libertinage du XVIIe siècle, de l'autre son valet Sganarelle, figure populaire attachée aux valeurs traditionnelles. Leur opposition crée une tension dramatique qui structure l'œuvre tout en illustrant les débats moraux et philosophiques de l'époque. Cette relation maître-valet dépasse le simple rapport hiérarchique pour devenir un véritable dialogue entre deux visions du monde antagonistes.
Le valet comme conscience morale du maître
Sganarelle incarne la voix de la morale face aux excès de Dom Juan. Alors que son maître multiplie les conquêtes et bafoue les conventions sociales, le valet exprime constamment sa désapprobation, rappelant les valeurs religieuses et les principes moraux de son temps. Cette fonction de Sganarelle correspond parfaitement à la vision que les apologistes du XVIIe siècle avaient du libertinage : une simple posture sociale masquant la licence des mœurs plutôt qu'une réelle position philosophique. À travers les remarques de Sganarelle, Molière fait écho aux critiques formulées par Garasse qui décrivait les libertins comme des personnes vivant comme si Dieu n'existait pas tout en comptant sur un repentir tardif. Le valet devient ainsi le porte-parole des arguments religieux face à l'imposture du maître, qui utilise la philosophie comme prétexte pour satisfaire ses désirs de domination et de séduction.
Le duo comique au service de la profondeur philosophique
Le contraste entre Dom Juan et Sganarelle génère non seulement des situations comiques mais sert aussi à approfondir la réflexion philosophique. Quand Dom Juan prononce ses discours sur la religion ou la séduction, c'est souvent devant Sganarelle, un interlocuteur incapable de les comprendre pleinement, ce qui souligne la faiblesse argumentative de ses positions. Ce décalage illustre parfaitement ce que Pascal considérait comme l'incohérence du raisonnement libertin, qualifié de « paradoxemonstrueux ». La dynamique comique du duo permet à Molière d'aborder des sujets graves comme le déisme, l'athéisme ou la mauvaise foi sans alourdir sa pièce. Les boutades philosophiques de Dom Juan, prononcées face à un valet dépassé, révèlent la superficialité de son libertinage qui sert avant tout de masque social à ses passions égoïstes. Cette utilisation du duo maître-valet pour confronter deux visions du monde – l'une ancrée dans la tradition religieuse, l'autre dans un libertinage de façade – fait de cette relation un puissant outil dramatique pour exposer les tensions intellectuelles et morales du XVIIe siècle.
La représentation du libertinage face aux valeurs religieuses
Le personnage de Don Juan, créé par Molière au XVIIe siècle, incarne la figure emblématique du libertin qui s'oppose aux normes morales et religieuses de son époque. Cette œuvre théâtrale propose une analyse fine des tensions entre les désirs individuels et les conventions sociales dans la France du Grand Siècle. Don Juan représente une remise en question des valeurs dominantes, utilisant le masque du libertinage pour assouvir ses pulsions et affirmer sa liberté face aux contraintes morales.
La transgression des codes moraux du XVIIe siècle
Dans la France du XVIIe siècle, le libertinage était perçu par les apologistes religieux comme une simple posture sociale plutôt qu'une véritable philosophie. Des penseurs comme Garasse décrivaient les libertins comme des « yvrognets » qui, tout en croyant au fond en Dieu, vivaient comme si cette croyance n'avait aucune incidence sur leur comportement. Ces hommes comptaient sur un repentir tardif, attitude dénoncée comme relevant de la mauvaise foi. Le Don Juan de Molière correspond précisément à ce portrait du « faux libertin » : son libertinage sert de masque à ses passions égoïstes et à sa quête incessante de plaisirs.
Don Juan n'est pas un révolutionnaire social. Au contraire, il s'inscrit dans les codes de son temps quand cela l'arrange. Son apparence soignée – perruque blonde, plumes, habits dorés et rubans – témoigne de son adhésion aux modes de la Cour. Sa technique de séduction repose principalement sur la promesse de mariage, transformant ainsi un sacrement religieux en simple outil de conquête. Cette instrumentalisation des conventions révèle un décalage flagrant entre son discours sur la séduction et sa pratique réelle, où il se montre parfois maladroit face à certaines femmes qu'il tente de séduire.
Le défi lancé à l'autorité divine et ses conséquences
L'attitude de Don Juan face à la religion illustre une forme particulière d'impiété que les penseurs de l'époque analysaient avec inquiétude. Marin Mersenne considérait que l'impiété des déistes relevait davantage d'une perversion de la volonté que d'une position philosophique cohérente. Selon lui, les libertins rejetaient la religion chrétienne principalement pour s'affranchir de sa morale contraignante. Pascal, quant à lui, voyait dans l'indifférence libertine un paradoxe monstrueux et un raisonnement incohérent, accusant les libertins de cultiver une insouciance dangereuse face aux questions d'éternité.
Don Juan utilise la philosophie libertine non pas comme une véritable quête intellectuelle, mais comme un moyen de justifier ses actions et d'asseoir sa domination. Ses discours philosophiques sont généralement prononcés devant des interlocuteurs incapables de les comprendre ou d'y répondre, ce qui souligne la faiblesse rhétorique de sa position. Sa motivation profonde reste matérialiste : profiter de sa fortune et de son rang social, dans l'attente de l'héritage paternel. Le libertinage devient ainsi un masque social qui dissimule une ambition bassement matérielle. La pièce de Molière montre comment ce défi lancé aux valeurs religieuses ne peut rester sans conséquence dans une société où la morale et la religion structurent l'ordre social. Don Juan apparaît finalement comme un imposteur qui instrumentalise la philosophie pour faire bonne figure et satisfaire ses désirs de domination.